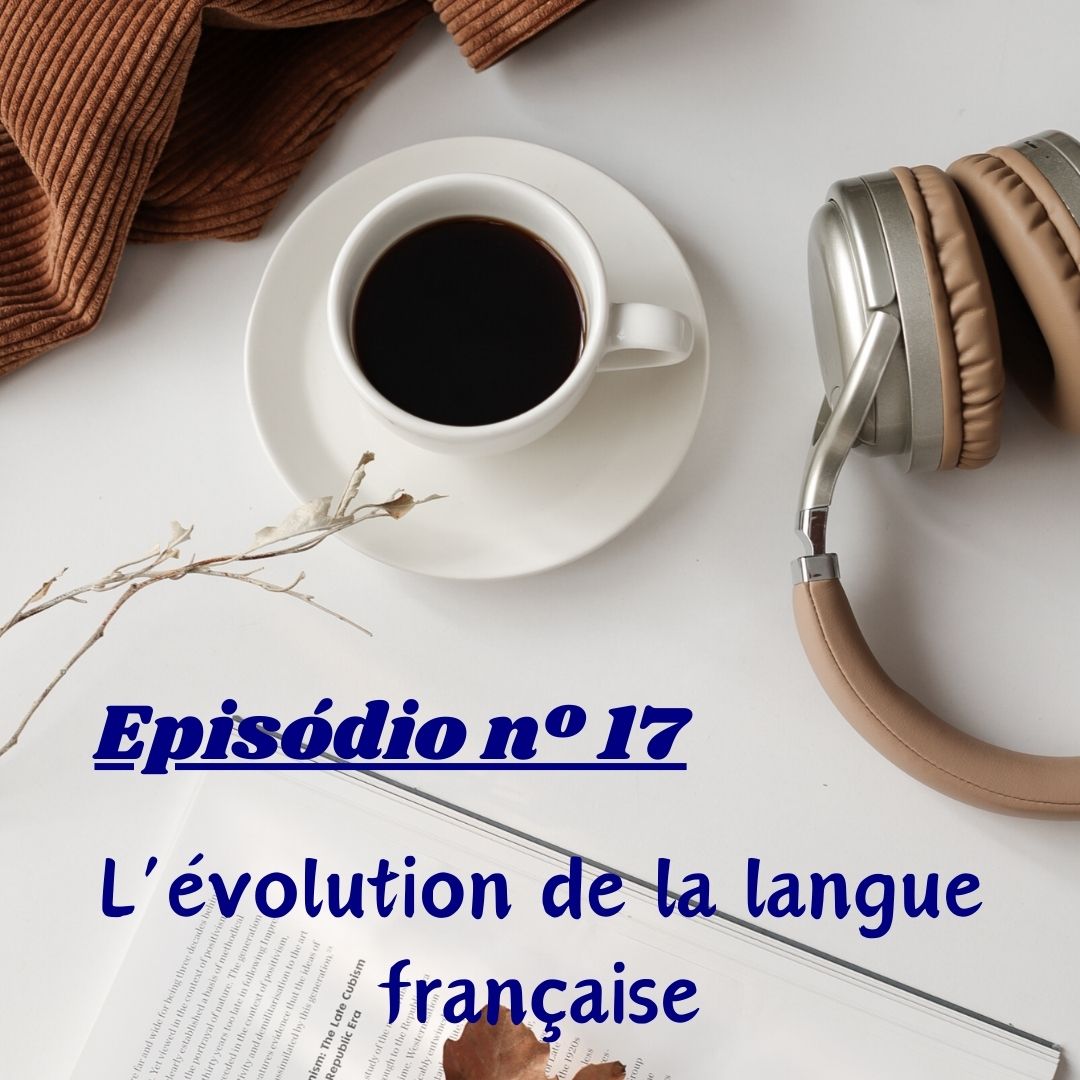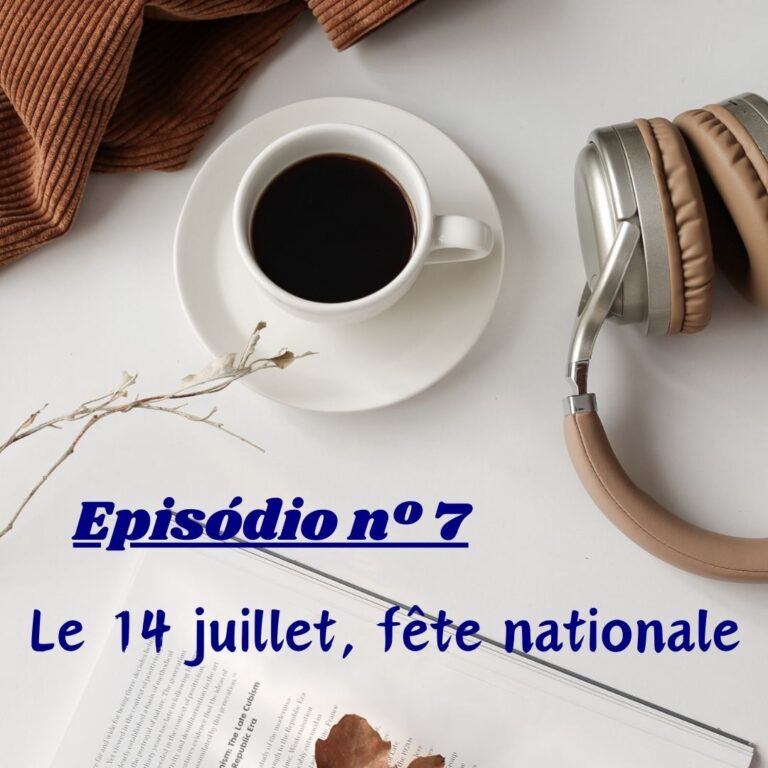Posté sur Spotify, Passionnément Podcast, le 25/11/2024.
Bienvenue sur « Passionnément Podcast », le podcast de Passionnément Français. Tous les 15 jours, je vous invite à découvrir un podcast sur une particularité culturelle ou historique de la France. Aujourd’hui, nous allons parler de l’évolution de la langue française.
Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont le français a émergé et évolué au fil des siècles ? Savez-vous qu’il est né d’un mélange d’influences latines vulgaires, celtiques, germaniques et bien plus encore ?
Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous explorons cet incroyable voyage, d’une langue rudimentaire parlée au cœur de l’Empire romain jusqu’à devenir la langue de la diplomatie, de la littérature et de millions de personnes à travers le monde.
- Les origines de la langue française.
Pour comprendre les origines du français, il faut remonter le temps… très longtemps ! Nous parlons du 1er siècle avant J.C., lorsque l’Empire romain a conquis la Gaule, la région que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de France. Mais à ce moment-là, que se disait-il ?
Eh bien, les habitants de la Gaule étaient les Gaulois, et leur langue principale était le gaulois, une langue celtique. Cette langue était largement parlée, mais l’arrivée des Romains a apporté des changements drastiques. Avec la domination romaine, le latin vulgaire, la langue utilisée par les soldats, colons et administrateurs romains, a commencé à se répandre.
Maintenant, pourquoi du « latin vulgaire » et pas du latin classique ? Le latin vulgaire était le latin de tous les jours, très différent du latin littéraire et plus formel utilisé par des écrivains comme Cicéron. C’était plus simple, plus pratique et donc beaucoup plus accessible aux populations conquises.
Mais, le passage du gaulois au latin vulgaire ne s’est pas fait d’un seul coup. Ça a été un processus progressif qui a duré des siècles. À cette époque, les deux langues coexistaient et le latin commençait à absorber des mots, des sons et des expressions du gaulois. Par exemple, des mots comme bouleau et chêne ont des racines celtiques qui subsistent encore aujourd’hui en français.
Et ce n’est pas seulement le gaulois qui a influencé le latin parlé dans la région. Au Ve siècle, avec la chute de l’Empire romain, les tribus germaniques, comme les Francs, ont commencé à envahir la Gaule. Le mélange du latin vulgaire et des langues germaniques a apporté de nouveaux sons et mots au vocabulaire local. C’est là que l’on commence à voir les premières caractéristiques qui distinguent le français des autres langues romanes, comme l’espagnol ou l’italien.
Par exemple, le nom « France » lui-même vient des Francs, et des mots comme guerre, blanc et garder ont des origines germaniques.
Un autre élément intéressant, c’est qu’au VIe siècle, la Gaule était un véritable patchwork linguistique. Il n’y avait pas une langue dominante unique, mais plutôt plusieurs dialectes qui variaient d’une région à l’autre. Ce n’est que plus tard que le dialecte francilien, appelé francien, commence à prendre de l’importance. Donc, le français est né d’une véritable fusion linguistique.
- L’ancien français.
Cette période dite de l’Ancien Français, qui s’étend approximativement du IXe au XIIIe siècle a été un moment crucial pour le développement de la langue française, où elle a commencé à se différencier plus clairement du latin et à acquérir sa propre identité.
Mais avant d’entrer dans les détails, il faut comprendre le contexte historique. Au IXe siècle, la Gaule n’est plus le cœur de l’Empire romain. Elle faisait désormais partie de l’Empire carolingien, fondé par Charlemagne. Bien que le latin soit encore la langue officielle de l’Église et de l’administration, on parlait déjà des dialectes dérivés du latin vulgaire, qui, au fil du temps, se sont de plus en plus éloignés de l’original.
- Le Serment de Strasbourg.
Un jalon important de cette période a été le Serment de Strasbourg, de 842. Il s’agit de l’un des premiers textes écrits en proto-français dont nous disposons. Il s’agit d’un accord militaire entre les petits-fils de Charlemagne, Louis le Germanique et Charles le Chauve. Le plus intéressant est que le serment a été rédigé en deux langues : le germanique et une forme ancienne du français. Cela montre qu’à cette époque le latin ne suffisait plus à garantir la compréhension mutuelle entre locuteurs.
- Les langues oïl et oc.
Les langues oïl sont parlées dans le nord de la France et les langues oc sont parlées dans le sud.
Ces noms proviennent des mots utilisés pour dire « oui » : « oïl » au nord et « oc » au sud. Le français standard que nous connaissons aujourd’hui est issu principalement du dialecte de l’oïl parlé en Île-de-France.
- Littérature en vieux français.
Cette période marque également l’émergence de la littérature en langue française. L’une des œuvres les plus connues de cette époque est La Chanson de Roland, une épopée écrite à la fin du XIe siècle. L’histoire célèbre la bravoure des chevaliers de Charlemagne et constitue l’un des premiers exemples de la littérature française.
- Caractéristiques du vieux français.
Au XIIIe siècle, le français présentait des caractéristiques très différentes de ce que nous connaissons aujourd’hui :
En grammaire, elle conservait encore de nombreuses terminaisons latines, mais commençait à les simplifier.
Pour le vocabulaire, l’influence germanique et celtique était très présente.
Pour le son, la prononciation était plus proche du latin vulgaire, avec des sons aujourd’hui disparus, comme le « h » aspiré.
- L’Église et l’éducation.
Bien que le latin domine encore dans les contextes religieux et académiques, le français commence à se développer en tant que langue de prestige, notamment dans les documents administratifs et la littérature. Il s’agissait d’une étape essentielle pour que le français devienne à l’avenir la langue officielle de la France.
La période du vieux français était donc pleine de changements et d’expérimentations. C’était une langue changeante, façonnée par l’histoire, la culture et les interactions sociales. Et c’est à partir de ce moment que le français commence à prendre forme comme langue indépendante.
- Le moyen français.
Cette période du moyen français s’étend approximativement du XIVe au XVIe siècle. C’est une époque de profondes transformations de la langue française, portées par des changements culturels, politiques et technologiques. Ici, le français a commencé à se consolider comme langue principale de France et à gagner en prestige dans tout le royaume.
Cette période est marquée par des événements historiques majeurs : la guerre de Cent Ans, la Renaissance et bien sûr l’émergence de l’imprimerie. Chacun de ces facteurs a eu un impact direct sur l’évolution de la langue.
Au XIVe siècle, la langue est encore une mosaïque de dialectes régionaux, mais le dialecte francien, parlé en région parisienne, commence à se démarquer. Pourquoi? Parce que Paris était le centre politique et culturel du royaume, et que son influence finissait par dicter les fondements de ce qui allait devenir le français standard.
- L’Edit de Villers-Cotterêt.
L’édit de Villers-Cotterêts (promulgué en 1539 par le roi François Ier) a été une étape très importante dans le développement du français. Ce décret précisait que tous les documents administratifs et judiciaires étaient rédigés en français, et non plus en latin.
Pour la première fois, le français est devenu officiel comme langue d’État, acquérant un statut qui appartenait auparavant au latin. Cette décision a non seulement standardisé l’usage de la langue dans tout le royaume, mais a également encouragé le développement d’une grammaire et d’une orthographe plus cohérentes.
- L’influence de la Renaissance.
La Renaissance a apporté une véritable explosion de culture, d’art et d’apprentissage en France. De ce fait, le français s’est largement enrichi d’emprunts à d’autres langues, principalement l’italien, dus à l’influence culturelle de villes comme Florence et Venise.
Des mots liés aux arts, à l’architecture et à la musique ont été incorporés au vocabulaire (par exemple: balcon, sonnet, fresque).
C’est aussi l’époque où la littérature française commence à s’épanouir. Des écrivains tels que François Rabelais, avec ses œuvres Gargantua et Pantagruel, et Clément Marot ont été des figures centrales de l’utilisation du français comme langue littéraire.
- La presse et la normalisation.
Un autre facteur crucial a été l’émergence de l’imprimerie au XVe siècle. L’invention de Gutenberg datant de 1440 est arrivée en France quelques décennies plus tard, permettant la production massive de livres. Et bien sûr, pour que ces livres soient lus par un plus grand nombre de personnes, un certain degré de standardisation de la langue était nécessaire.
Des grammaires et des dictionnaires ont commencé à émerger durant cette période, contribuant à stabiliser l’orthographe et la grammaire française. Cela ne veut pas dire que tout était tel que nous le connaissons aujourd’hui – l’orthographe était encore assez variable – mais c’était le début d’une recherche de règles qui rendraient la langue plus uniforme.
- Caractéristiques du moyen français.
Le moyen français avait des caractéristiques très différentes du vieux français et commençait à ressembler davantage au français moderne :
Pour la grammaire, de nombreuses terminaisons latines ont disparu et la syntaxe a commencé à être basée davantage sur l’ordre des mots que sur les déclinaisons.
Pour le vocabulaire, la langue s’est enrichie d’emprunts à l’italien et au latin de la Renaissance.
Et pour l’orthographe, des tentatives de standardisation ont commencé à émerger, mais il était encore courant de voir le même mot écrit de différentes manières.
- L’expansion du français.
Durant cette période, le français commence également à s’étendre au-delà des frontières françaises, principalement grâce à la colonisation et au rayonnement culturel du royaume. Bien qu’elle soit encore une langue en développement, elle commençait déjà à être reconnue comme une langue prestigieuse en Europe.
Le moyen français était donc une période de transition essentielle. La langue est passée d’une phase plus régionale et diversifiée pour devenir un outil d’unité nationale et d’expression culturelle. C’est à ce moment-là que le français commence à consolider ses fondations en tant que langue que nous connaissons aujourd’hui.
- Le Français moderne et contemporain.
La période du français moderne et contemporain s’étend du XVIIe siècle à nos jours. C’est l’époque où le français se consolide comme l’une des langues les plus importantes au monde, devenant synonyme de sophistication, de diplomatie et de culture.
- Le XVIIe siècle : la standardisation du langage.
Le XVIIe siècle est une période décisive pour la structure et le prestige du français. C’est ici que la langue commence à être officiellement standardisée, grâce aux travaux de l’Académie française, fondée en 1635 sur ordre du cardinal de Richelieu.
La mission de l’Académie était claire : créer des règles grammaticales et orthographiques pour unifier l’usage du français et protéger la « pureté » de la langue. C’est ainsi qu’est né le premier dictionnaire officiel, dont la production a commencé à cette époque, même si sa première édition n’a été publiée qu’en 1694.
Pourquoi cette standardisation était-elle si importante ? Parce que le français commençait déjà à être utilisé comme langue de la diplomatie européenne. Dans les traités internationaux, le français a remplacé le latin comme langue officielle. Cela a été formalisé, par exemple, dans le Traité de Westphalie de 1648.
La langue française a également acquis une grande visibilité grâce aux auteurs de l’époque. Des écrivains comme Molière, Racine ou Corneille ont élevé le français au rang de langue littéraire raffinée, avec des œuvres qui font encore référence en matière de théâtre et de poésie.
- Le XVIIIe siècle : le siècle des Lumières.
Le français du XVIIIe siècle a été façonné par le mouvement des Lumières. Des philosophes tels que Voltaire, Rousseau et Montesquieu ont utilisé ce langage pour diffuser les idées révolutionnaires d’égalité, de liberté et de raison. L’impact a été énorme : le français est devenu la langue de la philosophie et des sciences en Europe.
Un autre aspect frappant est la croissance de l’influence française dans le monde. Au cours de cette période, la France a étendu son empire colonial, amenant les Français dans des pays comme le Canada, les Caraïbes et certaines parties de l’Afrique. Cela a jeté les bases de ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Francophonie – l’ensemble des pays et des communautés qui ont le français comme langue officielle ou commune.
- Les XIXe et XXe siècles : modernisation et mondialisation.
Au XIXe siècle, la langue française a subi une série de changements importants. C’est à cette époque que le français a commencé à ressembler encore plus à la forme que nous lui connaissons aujourd’hui. Quelques fonctionnalités notables sont apparues comme la simplification de la grammaire (certaines structures plus complexes ont commencé à disparaître) et les emprunts linguistiques. Le français a incorporé des mots d’autres langues, comme l’anglais, en raison des innovations technologiques et culturelles de la révolution industrielle.
Au XXe siècle, avec la mondialisation, le français est confronté à un nouveau défi : l’influence croissante de l’anglais, notamment dans les domaines de la science, de la technologie et de la culture pop. Malgré cela, le français a conservé sa pertinence en tant que langue officielle au sein des organisations internationales, telles que les Nations Unies, l’Union européenne et les Jeux olympiques.
Un autre phénomène intéressant du XXe siècle a été l’adaptation du français à ses variantes régionales. Par exemple, au Québec, le français a acquis des caractéristiques uniques, tant au niveau du vocabulaire que de la prononciation. Dans les pays africains, le français s’est enrichi de mots et d’expressions locales, créant de nouvelles formes d’expression.
- Le XXIe siècle : le français dans le monde contemporain.
Aujourd’hui, le français est parlé par plus de 300 millions de personnes dans le monde. Il reste l’une des langues les plus enseignées comme langue seconde, aux côtés de l’anglais et de l’espagnol.
Cependant, le français contemporain est confronté à de nouveaux défis et tendances :
Tout d’abord, l’influence de l’anglais (surtout dans la technologie et la culture numérique) : de nombreux mots et expressions anglais ont été adoptés. Par exemple : e-mail, week-end et hashtag.
Il faut s’adapter au monde numérique : le français contemporain doit s’adapter aux communications rapides et informelles, telles que les SMS et les médias sociaux. Cela a donné naissance à l’argot et aux abréviations telles que mdr (mort de rire), dsl (désolé).
La diversité de la francophonie : Aujourd’hui, le français n’est pas seulement la langue de la France, mais celle d’un vaste éventail de cultures, des marchés de Dakar aux théâtres de Montréal. Cette diversité renforce et transforme constamment la langue.
Au fil des siècles, le français est passé d’un dialecte régional à l’une des langues les plus influentes au monde. Elle s’est adaptée aux changements politiques, culturels et technologiques, sans perdre son essence.
- Curiosités linguistiques sur le français.
Le français est une langue pleine de charme, mais aussi de particularités et de surprises ! Nous allons mettre en lumière quelques curiosités linguistiques qui montrent à quel point cette langue est unique et fascinante.
- Le français et son influence dans le monde.
Pendant des siècles, c’était la langue officielle de la diplomatie, utilisée dans les traités internationaux et dans les cours royales. De nombreux mots anglais, comme restaurant, ballet, genre et façade, viennent directement du français.
De plus, le français est la langue officielle de 29 pays, répartis sur cinq continents, ce qui en fait une langue véritablement mondiale !
- L’alphabet français : simple, mais plein d’accents.
Bien que le français utilise le même alphabet latin que le portugais, il possède cinq accents principaux qui donnent une touche unique aux mots (l’accent aigu, l’accent grave, l’accent circonflexe, le tréma et la cédille). Ces accents ne sont pas seulement décoratifs : ils peuvent complètement changer le sens d’un mot.
- Les « Nonante » et les différences régionales.
Si vous avez déjà étudié le français, vous avez peut-être trouvé étrange la façon dont on compte les nombres. En français standard, 80 équivaut à quatre fois vingt et 90 équivaut à quatre fois vingt plus dix.
Mais saviez-vous qu’en Suisse et en Belgique, on simplifie les choses ? Là, on dit octante ou huitante pour 80 et nonante pour 90. Beaucoup plus pratique, vous ne trouvez pas ?
- Mots sans traduction directe.
Le français contient des mots si spécifiques qu’ils sont difficiles à traduire directement. Par exemple :
Dépaysement : Le sentiment d’être en dehors de son environnement familier, quelque chose comme une « désorientation culturelle ».
Flâner : Marcher sans but, juste pour profiter de l’instant présent et du paysage.
Ces mots captent des nuances qui montrent à quel point le français est une langue riche en sensibilité.
- Le son « R » du français.
Le célèbre r guttural du français est l’un des traits les plus frappants de la langue. Cependant, ce son n’a pas toujours été utilisé ! Jusqu’au XVIIe siècle, le r se prononçait plus près du r roulé qu’on entend en espagnol ou en italien. C’est l’influence de la cour parisienne qui a popularisé le son guttural que nous connaissons aujourd’hui.
- Les mots les plus longs en français.
Saviez-vous que le mot le plus long en français est anticonstitutionnellement ? Il comporte 25 lettres et signifie quelque chose comme « de manière anticonstitutionnelle ».
Autre fait amusant : le français aime les mots composés et les expressions longues, mais il est également connu pour les abréger. Par exemple, la télévision devient télé et sympathique devient sympa.
- Les faux amis.
Les « faux amis » sont des mots qui semblent avoir la même signification en français et dans une autre langue, mais qui sont en réalité assez différents. Quelques exemples curieux :
entendre signifie « écouter », mais cela ressemble à « entender ».
attendre signifie « patienter », et non « atender ».
discuter signifie « converser » et non « discutir ».
Vous avez vu à quel point le français regorge de particularités ? Ces curiosités montrent comment la langue va bien au-delà des mots et reflète la culture, l’histoire et la manière d’être de ses locuteurs.
Et c’est ainsi que nous terminons cet épisode de l’évolution de la langue française ! Aujourd’hui, nous voyageons à travers les curiosités, les changements et les particularités qui rendent le français si fascinant.
La langue française nous montre qu’en plus d’être une forme de communication, elle porte en chaque mot une histoire, une culture et un monde de possibilités. De ses origines latines à son expansion mondiale, en passant par ses expressions uniques et ses variantes régionales, le français ne cesse de nous surprendre et de nous ravir.
En regardant vers l’avenir, la grande question est : comment le français va-t-il continuer à évoluer ? Sera-t-il capable de conserver sa pertinence dans un monde globalisé et dominé par la technologie ?
Si vous avez aimé l’épisode, n’oubliez pas de suivre notre podcast sur votre plateforme préférée. De cette façon, vous restez au courant de tous les nouveaux épisodes. Et bien sûr, si vous le pouvez, partagez-le avec vos amis et votre famille également intéressés par les spécificités de la France.
Si vous avez des questions, des suggestions de sujets ou une curiosité sur la culture française dont nous n’avons pas discuté, laissez un commentaire. Ce sera un plaisir de pouvoir en parler.
Merci d’avoir suivi ce podcast, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine !